|
|
|
Le chapitre
|
|
|
|
|
 |
|
Dernière mise à jour le
|
Thème A : Fonctionnement du corps humain et santé
1. Le mouvement et sa commande
1. Le mouvement et sa commande
1. Plan du cours
I. Introduction
A. Quelles sont les modifications subies par l’organisme au cours d’une activité sportive ?
On constate que :
- l'on est essoufflé (augmentation du rythme respiratoire),
- notre cœur bat plus vite (augmentation du rythme cardiaque),
- l’on transpire (risque d’élévation de la température corporelle),
- nos muscles sont fatigués et quelques fois font mal.(courbatures).
B. Quels sont les organes impliqués dans la réalisation de nos mouvements?
Bordas, doc. 1 et 2, p. 22 & 23.
Lors d’un mouvement ou d’une activité sportive, notre organisme réalise de nombreux mouvements qui font intervenir les muscles, les os et les articulations
Le cerveau et les organes des sens (yeux, oreilles…) permettent la précision de nos mouvements.
La poursuite d’une activité musculaire nécessite que le muscle reçoive du sang (appareil circulatoire), porteur d’oxygène (appareil respiratoire) et de nutriments (appareil digestif).
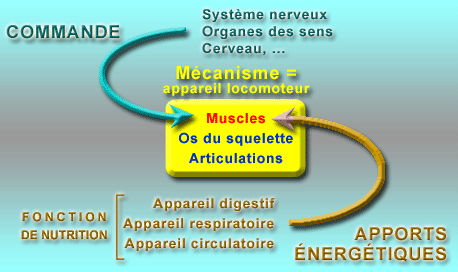
C. Etude d’un mouvement simple : la flexion et l’extension.
Bordas, doc. 1 et 2, p. 10 & 11.
- Ils existent 3 sortes de mouvements : les mouvements de flexion, d’extension et de rotation.
- Flexion et extension sont les deux mouvements opposés d’un segment par rapport à un autre (ils permettent de revenir à la position initiale), ils sont antagonistes..
Schéma réalisé à partir des documents 2 b et c, manuel Bordas p. 11).
Remarque : les documents ne nous permettent pas de savoir la relation qui existe entre les muscles et les autres organes. L'observation d'une patte antérieure de mouton vendue en boucherie ("épaule de mouton") apportera la réponse à cette question.
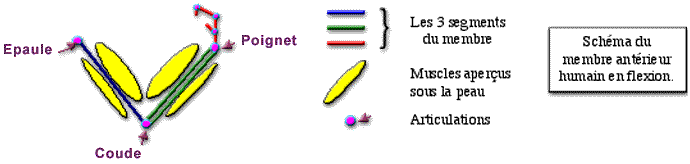
- Les segments osseux donne la rigidité au membre.
- Les muscles sont responsables des mouvements entre deux segments.
- Les articulations rendent possibles les mouvements de deux segments.
II. Etude du fonctionnement des muscles
A. Observation du muscle du mollet lors de l'extension du pied
| Longueur du muscle du mollet (en cm) | Diamètre du mollet (en cm) | |
| Pied au repos | 32,5 cm | 9,5 cm |
| Pied en extension | 31 cm | 10,5 cm |
- Lorsque que le pied est en extension, le muscle du mollet se contracte.
- On constate qu'un muscle qui travaille qui se contracte,
- se raccourcit,
- augmente de circonférence, donc de diamètre (il gonfle),
- durcit.
B. Comment le muscle agit-il pour provoquer un mouvement ?
1) Observation de la patte antérieure du mouton
Observation collective par caméra et écran de télévision
- Puisque le muscle sert à faire bouger un segment osseux par rapport à un autre, nous rechercherons :
- Quel lien existe entre un muscle et les os de 2 segments?
- Où se situent les insertions du muscle pour qu'un segment bouge (l'avant-bras par ex.) et l'autre (le bras) reste fixe?
- En quoi consistent les articulations?
- Fiche T.P. 2

- Observation du squelette et de l'appareil musculaire sur une photographie de la patte préparée

Un muscle est composé de deux parties :
- La partie centrale ou ventre, motrice, qui se contracte (se raccourcit lors de la contraction)
- Les tendons blancs et non déformables, situés aux deux extrémités.
- Ils fixent le muscle aux os de deux segments.
- Ils transmettent ainsi le raccourcissement du muscle aux os des segments.
2) Schéma de la patte antérieure de mouton. Corrigé
Barème du corrigé
III. L'articulation permet le mouvement d'un segment par rapport à un autre
Les os sont rigides et ne se plient pas. Pour plier le corps, il faut des articulations.
A. Il existe plusieurs types d'articulations.
Manuel page 14
- Les radiographies interprétées et l'observation des mouvement possibles sur son propre corps, mettent en évidence la différence qui existe entre le fonctionnement :
- de l'épaule
- qui permet des mouvements dans les 3 dimensions,
- La tête de l'humérus en forme de rotule (sphère) se loge dans la large cavité articulaire de l'omoplate.
- du coude
- qui limite les mouvements dans un seul plan : flexion - extension.
- La tête cylindrique de l'humérus vient se loger étroitement dasn une cavité en forme de gouttière constituée principalement par la tête du cubitus (et partiellement celle du radius).
- de l'épaule
Document montrant le fonctionnement de 4 types d'articulations ![]()
B. Schéma de la coupe d'un articulation.
Manuel page 15
- Les articulations sont organisées pour permettre le mouvement entre deux segments osseux rigides :
- les têtes des os s'emboîtent plus ou moins complètement,
- les ligaments maintiennent les têtes des os en place,
- les cartilages articulaires lisses facilitent le glissement des têtes osseuses l'une sur l'autre,
- le liquide synovial huileux, lubrifie (cartilage et synovie empêchent les frottement et l'usure des os).
IV. Maquette représentant les mouvements antagonistes d'un segment par rapport à l'autre (comme l'avant-bras par rapport au bras).
- Avant de commencer la réalisation de la maquette. Se poser des questions :
- Quels sont les organes concernés par ce modèle ?
- Quelles les caractéristiques essentielles de ces organes ?
- Quelles sont les fonctions assurées par ces organes ? Et quelles fonctions désire-t-on modéliser ?
- Et ce, afin d'envisager une manière simplifiée de représenter ces organes tout en conservant la fonction qu'on désire mettre en évidence.
- Répondre à ces questions sur le cahier.
- Réaliser le modèle, si possible le photographier à différentes étapes de son fonctionnement. Légender les photos.

- Un exemple est fourni dans votre manuel page . Un lien vers un site, propose différentes maquettes fonctionnelles

V. Le fonctionnement des muscles antagonistes est coordonné
- Il résulte de la fabrication de la maquette, que le fonctionnement des muscles antagonistes est coordonné.
- Le muscle qui se contracte, est moteur, il est responsable du mouvement.
- Le muscle antagoniste est alors passif et est étiré malgré lui.
- Exemple, dans le mouvement de l'avant-bras (manuel, doc. 2c, p. 17), lorsque le biceps, muscle moteur, se contracte pour effectuer une flexion, le triceps qui est passif, est étiré par le mouvement de flexion.
- On observe souvent un développement différent des muscles antagonistes.
- Chez l'Homme le biceps responsable de la flexion de l'avant-bras est plus développé que le triceps (il nous aide à soulever les objets).
- En observant la patte antérieure de mouton, nous avons remarqué que le triceps, muscle extenseur de l'avant-bras était le plus développé (il participe en effet à la station debout, à la marche et au saut).
VI. Schéma du squelette humain
VII. Les accidents et les déformations du squelette
- De bonnes positions du corps et des exercices physiques favorisent le développement harmonieux de l’appareil locomoteur.
- Corrigé

VIII. La commande nerveuse du mouvement
A. Comment le système nerveux intervient-il dans la réalisation du mouvement ?
1) Qu'est-ce qui déclenche un mouvement ?
| Exemple | Information perçue | Organe qui reçoit l'information | Organes qui effectuent le mouvement | |
| Arrêt du ballon par un gardien de but | Lumière réfléchie par le ballon Image du ballon |
Les yeux | Les muscles des quatre membres | |
| Retrait de la main sous l'effet d'une brûlure | Chaleur de forte intensité | La peau | Les muscles du membre supérieur du côté de la main |
2) Schématisation.

- Le mouvement peut être déclenché par une stimulation extérieure reçue par un organe des sens.
- Les organes des sens reçoivent les informations du monde extérieur à l'organisme.
- Exemple : yeux, peau, oreille ,nez ,bouche.
- Les informations provenant du monde extérieur à l'organisme sont appelées des stimulations extérieures.
- Exemple : image (lumière), contact (texture, température), son, odeur .
B. Que deviennent les informations enregistrées par les organes des sens ?
Hypothèse : les informations sont envoyées au cerveau et traitées par lui avant d'être transmises aux effecteurs.
1) Etude d'observations médicales (accidents, maladies, expérimentation).
Manuel, doc. 2b, p. 19 et
5. Une hémorragie cérébrale peut entraîner la destruction de certaines parties du cerveau. Les conséquences pour la personne atteinte sont souvent graves : impossibilité de parler, paralysie d'une moitié du corps, perte de la vision, etc."
| Accident ou dysfonctionnement | Conséquences pour la personne | Interprétations | |
| 1. | Fracture de la colonne vertébrale. | Les muscles de la partie inférieure du corps ne fonctionnent plus. | Cet accident de l'axe osseux du squelette a endommagé le système nerveux. |
| 2. | Section du nerf au niveau du poignet. | Les muscles de la main ne fonctionnent plus. | Le nerf intervient dans la transmission d'ordres de mouvement donnés aux muscles. |
| 3. | Maladie de la moelle épinière. | Mauvais fonctionnement des muscles. | La moelle épinière intervient dans la transmission d'ordres de mouvement donnés aux muscles. |
| 4. | Excitation d'un région du cerveau. | Contraction de muscles spécifiques. | Le cerveau donne les ordres de mouvements. Différentes zones du cerveau sont dédiées aux différentes parties du corps. |
| 5. | Hémorragie cérébrale | Pertes de motricité et de sensibilité | Le cerveau donne des ordres de mouvements. Il est aussi responsable de l'interprétation des informations provenant des organes des sens. |
2) Conclusion
- Les informations circulent dans la moelle épinière et les nerfs.
- La moelle épinière, située dans la colonne vertébrale, et le cerveau, situé dans le crâne, sont des centres nerveux.
- Les nerfs et les centres nerveux sont les intermédiaires entre les organes des sens et les muscles pour réaliser des mouvements.
- Le cerveau centralise les informations provenant des organes des sens et commande la contraction des muscles lors des mouvements volontaires.
- Mouvement volontaire: mouvement que l'on a décidé de réaliser.
C. Quel est le trajet exact des informations entre les organes des sens, les centres nerveux et les muscles ?
- Corrigé de l'activite avec le logiciel CMD

- L'observation de la dissection d'un vertébré montre que le système nerveux est formé des :
- CENTRES NERVEUX
- l'encéphale protégé par la boîte crânienne
- la moelle épinière protégée par la colonne vertébrale
- NERFS
- les nerfs crâniens reliés directement à l'encéphale
- les nefs rachidiens reliés à la moelle épinière.
- CENTRES NERVEUX
Nouvelle schématisation des informations recueillies.
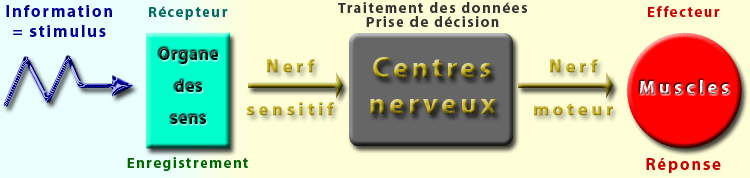
D. Schéma bilan de la commande nerveuse du muscle effectuant un mouvement
E. Hygiène du système nerveux
Le bilan de ce chapitre sur le thème nutrition - Le fonctionnement et les besoins d'un organe : le muscle. Accessible depuis le thème "Fonctionnement de l'organisme".
Pour réviser. Deux petits logiciels et les questionnaires correspondant à compléter.